En 1936, les manuels d’éducation ménagère indiquaient que, l’hiver, 16 degrés était une température maximale à ne pas dépasser dans une maison sous peine de complications physiologiques.
En tombant sur cette information, j’ai eu envie de comprendre d’où venait la fameuse injonction à « chauffer à 19 °C » qu’on entend partout avec la flambée des prix de l’énergie.
Pourquoi dit-on qu’il faut chauffer à 19 °C l’hiver ?
2 raisons expliquent cela :
1. Le chauffage représente plus de la moitié des consommations énergétiques d’un logement, c’est donc l’un des principaux postes de dépenses à analyser.
2. Selon l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), un degré de moins correspond à 7 % d’économie d’énergie. L’idée était donc d’inviter les personnes à baisser leur consommation de seulement 1 degré (en passant de 20 à 19 °C) et ainsi d’enclencher une baisse progressive.
Mais, l’hiver, la température idéale d’une maison est loin d’être universelle ! Elle varie selon les époques et les régions du monde.
La zone de confort thermique pour un individu inactif et légèrement vêtu se situe d’ailleurs :
– entre 14,5 et 21 °C pour les Anglais ;
– entre 20 et 26 °C pour les États-Unis ;
– entre 23 et 29,5 °C pour les habitants des régions tropicales.
Mais au-delà de ces différences culturelles, j’ai surtout fini par comprendre que le confort thermique n’est pas qu’une question de température.
Et je trouve ça particulièrement intéressant pour celles et ceux qui souhaitent réduire encore leur facture de chauffage (que ce soit pour réduire leur empreinte carbone ou pour faire des économies).
Ainsi, la température idéale d’une maison l’hiver n’est pas une question de chiffres sur un thermomètre, mais surtout de ressenti. Trois principaux facteurs influencent ce ressenti, et c’est ce que nous allons voir dans la suite de cet article.
Les 3 facteurs qui influencent la température ressentie

1. La température des parois
La température ressentie dans un espace n’est pas simplement une mesure de la température de l’air. Elle est également influencée de manière significative par la température des parois environnantes.
Cette relation peut être exprimée par la formule suivante :
Température ressentie = (température de l’air + température de la paroi) / 2
Cela signifie qu’en hiver, nous aurons la même sensation de confort :
– si les murs et l’air sont à 19° que si l’air est à 21° et les murs à 17° ;
– et avec des murs à 14°, il faudra surchauffer l’air à plus de 25°.
Ces exemples montrent que plus les murs sont froids, plus il faut chauffer l’air pour atteindre une sensation de confort. Des murs plus froids exigent donc plus d’énergie pour maintenir une température ressentie de 19 °C.
L’écart entre la température de l’air et celle des parois peut également causer un inconfort, en particulier si la différence est de plus de 4 degrés. Cela s’explique par le fait que notre corps réagit non seulement à la température de l’air, mais aussi à la température rayonnante des surfaces qui nous entourent.
Lorsqu’on communique sur le fait de « chauffer à 19 °C », on sous-estime l’influence de la température des parois.
Cette compréhension du rayonnement des parois sur le confort explique pourquoi certaines méthodes de chauffage, comme les planchers chauffants, sont si attrayantes.
En chauffant directement les surfaces avec lesquelles nous sommes en contact, ces systèmes peuvent créer une sensation de confort même lorsque la température de l’air est relativement basse.

Crédits photos : Glenna Haug Unsplash
2. L’humidité relative de l’air
L’humidité relative de l’air joue un rôle déterminant dans la sensation de confort de nos espaces de vie.
Elle n’affecte pas seulement notre bien-être physique, mais peut aussi avoir un effet sur notre habitation elle-même.
Analysons comment l’humidité fonctionne et comment elle peut être gérée pour optimiser notre confort.
- Trop d’humidité. Si l’air est trop humide, cela conduit à des sensations désagréables et la condensation peut apparaître sur les parois. Outre l’inconfort thermique, cela entraîne des problèmes de moisissures et de dégradation du bâtiment.
- Trop peu d’humidité. À l’inverse, si l’air est trop sec, cela peut entraîner un assèchement des muqueuses, ce qui est désagréable et peut même avoir des conséquences sur la santé.
L’humidité relative de l’air provient de diverses sources, notamment la respiration humaine, la cuisson des aliments, la douche, le linge qui sèche en intérieur… Les conditions climatiques extérieures peuvent également avoir une incidence sur l’humidité intérieure.
Comment réduire l’humidité relative de l’air ?
Pour réduire l’humidité relative de l’air, il faut :
- un système de ventilation adéquat. Une ventilation efficace aide à contrôler l’humidité en évacuant l’air humide et en apportant de l’air frais et sec. Cela contribue à prévenir la condensation et maintient un niveau d’humidité confortable ;
- des parois respirantes. L’utilisation de matériaux qui permettent aux parois de « respirer » peut aider à réguler l’humidité. Cela contraste avec le problème des maisons « tupperware », où l’étanchéité excessive peut piéger l’humidité à l’intérieur, créant des problèmes de confort et de santé.
Poêle à bougie
Contrairement à ce que son nom laisse penser, cet objet low-tech n’est pas un moyen de chauffage mais un moyen simple et efficace de réduire l’humidité relative de l’air.
Si vous vous intéressez aux low-techs, alors vous n’avez sûrement pas envie d’acheter un déshumidificateur électrique ou chimique.
Et le poêle à bougie est une alternative peu coûteuse et facile à fabriquer ! Le système est simple, on allume quelques bougies sous 2 pots en terre cuite entre lesquels on a laissé un espace pour que l’air circule.
3. Les mouvements d’air
L’air en mouvement accélère les échanges thermiques par convection au niveau de la peau.
Plus la vitesse de l’air est élevée, plus la déperdition de chaleur est grande.
C’est pourquoi nous ressentons une sensation de fraîcheur quand nous sommes près d’un ventilateur l’été. Ce même principe peut augmenter la sensation de froid en hiver si l’air se déplace rapidement à l’intérieur.
Les mouvements d’air peuvent provenir de plusieurs sources :
- Inétanchéités du bâtiment. Les fissures et les espaces dans les murs, les fenêtres, et les portes laissent l’air s’infiltrer, créant des courants d’air inconfortables et augmentant les besoins en chauffage.
- Systèmes de ventilation. Les systèmes de ventilation, s’ils sont mal conçus ou mal réglés, peuvent générer des mouvements d’air.
- Différence de pression atmosphérique. La différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur aura les mêmes effets, en particulier dans les bâtiments de grande hauteur.
Par exemple, les radiateurs soufflants doivent chauffer plus fort pour compenser l’inconfort créé par les mouvements d’air qu’ils génèrent. Cette exigence peut les rendre moins efficaces en termes d’énergie et moins confortables que d’autres options de chauffage.
Le principe Slow Heat : chauffer les corps plutôt que les espaces.
Le principe du Slow Heat a été imaginé par l’architecte Denis De Grave.
L’idée est de chauffer au plus près du corps plutôt que de chauffer l’intégralité de l’air d’un bâtiment. C’est un prolongement direct des 3 facteurs expliqués juste avant.
L’objectif est d’apporter du thermique confort aux personnes, et pas simplement de regarder un chiffre sur un thermomètre.
Le Slow Heat cherche à maximiser l’énergie utilisée pour vous tenir chaud et permet de passer un cap supplémentaire si vous souhaitez réduire la quantité d’énergie que vous utilisez. C’est un concept qui se situe à l’opposée de l’idée de simplement « chauffer à 19 °C ».
C’est par exemple le principe du kotatsu japonais. Cette table portable dissimule un petit chauffage (historique au charbon et désormais électrique). Les habitants de la maison s’installent autour de cette table, jambes repliées ou allongées, pour les réchauffer. Ce système de chauffage près du corps, plutôt que chauffant l’intégralité de la pièce, permet de réduire la consommation de charbon. Le tout peut être recouvert d’une couverture pour minimiser la perte de chaleur.

Ce principe a inspiré le laboratoire citoyen Atelier 21 qui a utilisé cette technique pour créer un poste de travail sur ordinateur qui maintient les jambes au chaud pendant que vous travaillez. Ils expliquent ici comment réaliser ça chez vous.
Conclusion : chauffer à 19 °C, comment s’y prendre ?
Chauffer à 19 °C est donc un concept flou ? Oui, vous l’avez compris, la température idéale d’une maison l’hiver n’est pas qu’une question de réglage du thermostat. C’est une combinaison complexe de facteurs qui, ensemble, créent une sensation de confort thermique et déterminent la quantité d’énergie nécessaire pour maintenir cette sensation.
La qualité et l’emplacement de l’émetteur de chaleur sont donc des composants essentiels du confort thermique d’une maison. Cela explique l’importance :
- des ouvertures exposées au soleil (baies vitrées, serres, murs capteurs…),
- des émetteurs de chaleur inclus dans les parois (type planchers chauffants),
- des émetteurs de chaleur qui permettent de réguler l’humidité de l’air (comme les poêles à bois).
Comprendre ce qui constitue le confort thermique, c’est aussi comprendre comment améliorer l’efficacité énergétique de votre maison et donc comment réaliser des économies d’énergie.
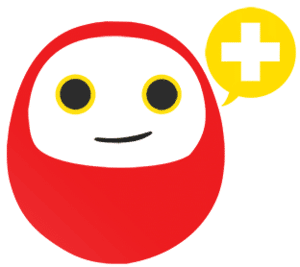
Pour aller plus loin
5 techniques pour isoler en chanvre votre maison
Les matériaux et techniques incontournables pour construire une maison écologique
Comment utiliser tous les avantages de l’énergie solaire dans votre maison ?
Vous avez un projet de vie nomade et vous aimeriez savoir comment vivre sur les routes ? Découvrez notre guide gratuit pour lancer votre activité de créateur freelance.

